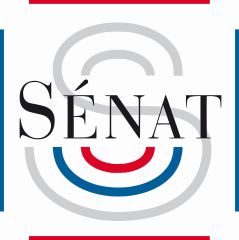Le constat général
- On compte 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs et 1153 organismes publics nationaux.
- Le mouvement d’agencification s’est opéré sans vision ni stratégie d’ensemble, entraînant des redondances, une dilution des responsabilités et une perte de lisibilité de l’action publique.
- Ce foisonnement se traduit en conséquence par une tutelle ministérielle affaiblie, une communication éclatée des agences qui brouille la parole publique ainsi qu’une complexité accrue pour les collectivités et les usagers, confrontés à une multiplicité d’interlocuteurs.
- Enfin, les coûts de gestion s’en trouvent alourdis sans générer d’économies notables.
Le cas des agences à vocation territoriale (ANCT, ADEME, ANRU, ARS…)
- UNE TUTELLE INEFFICACE
- L’État lui-même peine aujourd’hui à disposer d’une vision consolidée des missions de ces structures, de leurs effectifs et de leurs budgets. Les tutelles ministérielles, partagées entre plusieurs administrations centrales, ne permettent pas d’orienter effectivement les actions des agences, ni d’assurer un pilotage fin de leurs ressources et moyens.
Le cas de l’ADEME illustre cette tendance préoccupante d’une autonomisation croissante de certaines agences par rapport à la décision politique, les conduisant à redéfinir ou élargir leurs propres missions.
L’ADEME ne produit ainsi aucun travail notable sur le sujet de la lutte contre les nuisances sonores au cours des dernières années, alors même que cette mission lui a été explicitement confiée par le législateur.
À l’inverse, l’agence s’est vu confier par le SGPI une mission de renouvellement forestier dans le cadre du programme France 2030, alors que cette compétence ne lui appartenait pas et que l’ONF apparaissait comme l’opérateur naturel sur ce sujet. Cette absence de cohérence témoigne d’un défaut de contrôle de la tutelle.
- UNE COMMUNICATION QUI BROUILLE ET DESSERT LA PAROLE PUBLIQUE
- Les agences confient une partie de leur communication à des cabinets privés.
À titre d’exemple, le contact avec l’ADEME dépend de prestataires différents selon les régions. Une telle pratique est d’autant plus discutable que l’ADEME dispose d’équipes internes importantes en communication, pour un total de près de 20 ETP.
- La commission d’enquête considère que ces pratiques nuisent à la lisibilité de l’action de l’État et constituent un mauvais usage des deniers publics.
- DES AGENCES QUI PARTICIPENT DE L’ILLISIBILITÉ DE L’OFFRE D’INGÉNIERIE ADRESSÉE AUX COLLECTIVITÉS
- Le paysage de l’ingénierie publique est marqué par une multiplicité d’acteurs : agences nationales (ADEME, ANCT, Cerema, agences de l’eau…), services déconcentrés de l’État (DREAL, DDT…), organismes parapublics (CAUE), bureaux d’études privés, etc.
- Cette fragmentation concourt à une complexité du panorama des interlocuteurs susceptibles d’accompagner les collectivités dans leurs projets et donc d’une perte d’opportunité pour les élus qui se privent, faute de les connaître, de dispositifs prévus pour répondre à certains besoins.
- Cela a notamment été illustré par le président du conseil d’administration de l’ANCT lors de son audition devant la commission d’enquête, qui rappelait que « les maires qui souhaitent mettre en place un réseau de chauffage urbain doivent solliciter l’ADEME pour mobiliser le fonds Chaleur, encore faut-il qu’ils sachent que l’ADEME peut les accompagner dans ce projet ».
- Les compétences complémentaires et les modalités d’intervention hétérogènes des différentes agences imposent en outre aux bénéficiaires de nouer des contacts multiples, conduisant à un dialogue parfois incompréhensible lorsque des doublons sont constatés.
- DES AGENCES DONT L’ACTIVITÉ SE FAIT AU DÉTRIMENT DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT
- L’ADEME et l’ANCT mettent légitimement en avant l’expertise de leurs ingénieurs. Toutefois, l’État disposait historiquement, au sein des DDE, d’ingénieurs de haut niveau, issus notamment du corps des ponts et chaussées, capables de piloter des projets complexes (viaducs, tunnels, infrastructures routières).
- En transférant progressivement des compétences vers les agences, l’État a contribué à l’affaiblissement de ses services déconcentrés (DREAL et DDT, DREETS ou DDETS), vidés de leurs missions techniques et stratégiques. Près de 80 % de leurs missions se résument aujourd’hui à du suivi de financement ou du contrôle de légalité. Ce modèle est à bout de souffle.
- Depuis plusieurs décennies, les services préfectoraux ont ainsi été méthodiquement dépossédés de leurs moyens humains, de leurs expertises et de leurs leviers d’action. La décentralisation, puis l’agencification, ont contribué à un affaiblissement préoccupant des capacités d’intervention des préfets.
Les recommandations
- La commission d’enquête sénatoriale a présenté ses recommandations autour de deux priorités :renforcer le pilotage de l’administration centrale et affermir l’autorité du préfet comme unique chef de file territorial.
- Au-delà des gains financiers estimés à près de 540 millions d’euros, à politiques publiques inchangées, l’enjeu principal est de restaurer la lisibilité, la cohérence et la responsabilité de l’action publique.
Pour les agences à vocation territoriale, les principales recommandations sont les suivantes :
- LA SUPPRESSION DE L’ANCT ET LE TRANSFERT DE SES MISSIONS VERS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT
- Ses missions et personnels seront transférés aux DREAL et DDT(M), déjà en contact quotidien avec les élus locaux (PLU/PLUI, prévention des risques, gestion des fonds, agriculture, eau et biodiversité, climat…).
- LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DE L’ANRU ET LE TRANSFERT DE SES MISSIONS VERS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT
- Ses missions et personnels seront transférés aux DDETS(PP), qui sont en mesure de porter une vision plus large du renouvellement urbain, intégrant les dimensions sociales, culturelles, éducatives et de mobilité, souvent négligées dans les plans actuels.
- Sous l’autorité du préfet, les DDETS(PP), déjà en charge de ces enjeux, pourront demain intégrer les plans de renouvellement urbain à des feuilles de routes déjà existantes, tout en intégrant les partenaires de financement (Action Logement, bailleurs, Caisse des Dépôts…), sous l’autorité du préfet, en proposant l’élaboration de plans concertés et plus globaux, s’inscrivant dans une réelle logique d’aménagement du territoire.
- Ce transfert ne remettrait pas en cause les engagements de l’ANRU au titre des projets de rénovation urbaine dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
- LA TRANSFORMATION DE L’ADEME EN UNE AGENCE D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES, ET LE TRANSFERT DE SES MISSIONS A DESTINATION DES COLLECTIVITES ET ACTEURS PUBLICS VERS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT
- Ses missions exercées à destination des collectivités territoriales et autres acteurs publics seront transférées aux services déconcentrés de l’État, garants de la cohérence nationale en matière de transition écologique.
- L’ADEME conservera donc ses missions d’accompagnement des entreprises en matière de transition écologique, qui ne relèvent pas de la compétence des préfets, davantage concentrés sur l’accompagnement des entreprises en matière de développement économique.
- Les orientations stratégiques seront décidées au niveau national et déclinées localement par les services déconcentrés, à travers différents outils de financement (dont l’évolution en une subvention/dotation unique pourrait être envisagée) à même d’accompagner les territoires à travers une vision intégrée de leurs dynamiques (mobilités, logement, énergie, biodiversité), et sur une grande diversité de leviers (PCAET, PLU, GEMAPI…).
- LA SUPPRESSION DES ARS ET LE TRANSFERT DE LEURS MISSIONS À DE NOUVEAUX SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT
- Les ARS en tant que structures juridiques autonomes seront supprimées, et leurs missions et personnels transférés à de nouveaux services déconcentrés de l’État, les directions régionales et départementales de la santé, placées respectivement sous l’autorité des préfets de région et de département afin de mieux coordonner l’action territoriale de l’État en matière de santé.
- Cette solution vise à recentraliser la régulation sanitaire tout en la rapprochant du niveau départemental pour plus de proximité opérationnelle, à travers une chaîne de commandement unifiée (ministère → préfet de région → préfet de département) tout en maintenant un échelon de coordination régionale.
- Cette solution crée en outre un guichet unique local de l’État pour les élus en matière de santé.
Par exemple, un maire confronté à la fermeture d’un service d’urgence ou à la désertification médicale n’aurait plus à interpeller une agence régionale relativement autonome, mais pourrait saisir directement le préfet de département – avec qui il travaille au quotidien – ce qui faciliterait la remontée des problèmes et la co-construction de solutions. Cette reconnexion au terrain répond aux critiques selon lesquelles les ARS n’avaient pas su tisser des liens étroits avec les communes et départements. Par ailleurs, le préfet de département présiderait sans doute une instance de concertation sanitaire locale (adaptation des conseils territoriaux de santé actuels) où siégeraient les élus : leurs avis pourraient être plus directement pris en compte dans la décision, le préfet ayant la maîtrise d’ensemble.
- LA SUPPRESSION DE L’ANS ET LE TRANSFERT DE SES MISSIONS À DE NOUVEAUX SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT
- Les missions de l’ANS seront reprises par le ministère et l’INSEP. Les financements dédiés aux infrastructures sportives seront directement réorientés vers les collectivités territoriales.
- Cette solution vise à rendre plus claire, efficace et lisible la politique nationale en faveur du sport, alors que l’ANS se superpose aujourd’hui aux services du ministère, et attribue des aides financières conséquentes sans réelle transparence.
- LA SUPPRESSION DES STRUCTURES JURIDIQUES DES PARCS NATIONAUX ET DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET LEUR INTÉGRATION AU SEIN DE L’OFB
- Le statut juridique des onze parcs nationaux et du conservatoire du littoral évoluera, sans remise en cause de leurs missions.
- Alors qu’ils sont aujourd’hui des établissements publics, les parcs nationaux et le conservatoire du littoral seront réunis au sein d’une structure juridique commune, l’OFB, afin de permettre des économies de fonctionnement (sur la base du modèle existant pour les parcs naturels marins).
- À l’instar des parcs naturels marins, chaque parc restera doté d’un conseil de gestion autonome, associant élus, acteurs locaux et services de l’État pour assurer un équilibre entre protection des écosystèmes et développement maîtrisé des activités.